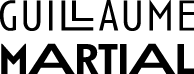
Philosophy & Photography Lab [Eng]
About the photograph The Balance, part of Quartiers Libres series.
—
Michael Spicher, writer and philosopher, founder of Aesthetics Research Lab, Boston
Guillaume Martial shot his latest photography series ironically titled, Open Spaces, inside and outside of Varennes-le-Grand prison. This particular photo “La Balance” presents the photographer at the corner with the markings of the Vitruvian Man.
His position at an outer corner of the prison demonstrates visually the way the building diminishes incarcerated persons. By placing his face close to the wall, Martial conjures the spirit of how painter Barnett Newman wanted people to view his work: by standing inches from the canvas so that you couldn’t see the edges, thereby inducing the sublime. The sublime, according to Immanuel Kant and Edmund Burke, provokes a feeling of awe often coupled with terror. Beholders feel their smallness in the universe. The sublime, in a way, puts the beholder in their place, which encourages humility and humanity. In the prison context, tension arises between the confining space and the seemingly endless time someone spends in prison, which squeezes out a person’s humanity. This is captured by Martial’s position in his photograph as each wall points toward an invisible horizon line in the distance. Only the bottom of the wall is in view.
The Virtuvian Man drawing sought to connect the human with nature, according to Leonardo da Vinci’s words. One thing suggested by the specific markings of the circle inside of a square is the human need for variety in lived spaces. Prisons fail in this regard, which can leave formerly incarcerated persons to struggle in various spaces upon release. Francis Hutcheson asserted that “uniformity amidst variety” contains an important aspect of beauty. Too little variety leads to boredom; too much variety leads to chaos. Variety, in Martial’s photo, is suggested subtly by the rectangle and circle, angles and curvature. Spaces that are overly monotonous deflate a person’s humanity; recent studies, for example, evince that a building’s blank facade affects people negatively, compared with a facade with some detail. People need variety to overcome boredom.
Martial adds a triangle below his photograph, which introduces the idea of its title: balance. In aesthetics, balance (or harmony or proportion) often refers to the physical qualities something possesses. And human proportion is suggested by the Vitruvian Man markings. However, I’m drawn to a metaphorical understanding, meaning the practical concerns of balancing the punishment of incarcerated persons with the desire for them to reintegrate into society afterward. Prison reform concerns a multitude of issues, but one that is neglected is aesthetics. The desire for aesthetics is a basic pleasure. Depriving incarcerated persons of this basic pleasure further removes them from what it means to be human. While acknowledging that restrictions and safety are necessary, the prison system ought to consider how aesthetic details could be integrated.
In this complex photograph, Martial visually creates an empathic vision of incarcerated persons. Spaces impact our well-being, so it’s not surprising that the space in prison damages people who are confined within its walls. This photo exemplifies their humanity.
————————————————————————————————————————————————————————————
Sarah Amane & Margot Rouas – historiennes de l’art [Fr]
—
Décors incarnés et théâtralisés
Guillaume Martial a l’art et la manière de jouer à cache-cache à la surface de ses images, et c’est dans la mise en scène de son propre corps qu’il déploie particulièrement ses talents. Ses photographies semblent être conçues autour de lui, comme si l’espace ne venait s’incarner que dans la pose qu’il adoptait, le mouvement qu’il figeait. Son corps est une silhouette dont les contours configurent l’image. Ainsi, il n’est pas question d’examiner la direction que prend l’objectif du photographe, mais plutôt le placement de ce dernier, sa participation physique au sein de la photographie.
Et c’est de cette construction scénique qu’émane l’aspect théâtralisé de ses images. L’artiste habite ses photographies de manière à les faire parler. Il multiplie les échos plastiques à la fois troublants et rassurants : bandeaux, arêtes et lignes courbes se répondent du corps au décor, du décor au corps. L’artiste parvient à faire l’autruche en gravissant des marches, à se fondre dans ce décor vertical tout en suggérant le mouvement, bien que personne ne soit dupe face à ce grotesque trompe-l’œil. Ce faisant, on ne peut que sourire devant les correspondances et les décalages de ces compositions, qui transforment n’importe quelle toile de fond en scène cocasse.
Je photographie – Jeu photographique
Être son propre modèle lui permet de parsemer chaque image d’une bonne dose d’autodérision, qualité indispensable pour contourner le sérieux si souvent attribué aux photographies. Car si le photographe ne se prend pas au sérieux, comment ses images pourraient l’être ? Et si ses images ne pèchent pas par orgueil, c’est parce qu’il met à jour le jeu qu’elles contiennent. Il se retrouve tête en bas, pieds en l’air, fonce droit dans le mur pour mieux s’y fondre. Lorsque le regard s’arrête sur une de ses images, il comprend vite que quelque chose cloche.
L’œuvre de Guillaume Martial ne se réduit pas à un simple je[u] : l’artiste s’adonne plutôt à des doubles-je[ux]. S’il manipule son corps et son personnage avec brio, il joue aussi avec le réel et détourne certaines valeurs généralement associées au medium photographique. Ce dernier ne coïncide plus exactement avec la réalité telle que nous la voyons de nos propres yeux, puisqu’à chaque fois l’artiste offre plusieurs degrés de lecture. Il s’agit un peu d’une partie au sein de laquelle le photographe et la photographie se renvoient – inlassablement – la balle.
En témoigne l’œuvre La raquette, à la perspective impraticable qui s’étale devant nous, prenant pour décor un fronton de pelote basque. Le joueur semble braver ici les lois de la gravité et, derrière des airs d’instants décisifs, l’image défie notre raison. Le photographe s’amuse, dégage des situations humoristiques ou insolites, dans lesquelles toute son anatomie est mise à profit, tandis que son visage se dérobe toujours à notre regard.
Mystère et boule de gomme
La construction de la scène reste un mystère et c’est sûrement de là que naît le plaisir de vaincre l’obstacle, mais un obstacle arbitraire, presque fictif, pour reprendre les mots de Roger Caillois. Si l’artiste joue avec le réel, c’est pour en dégager des aspects insolites qui prêtent à rire. Ses photographies ne sont pas des culs-de-sac, elles amènent plutôt le regardeur à déployer un scénario autour de l’image : à quoi ressemble la partie du corps qui est dissimulée ? Que se passe-t-il hors-champ ? Comment en est-il arrivé là ? Qu’est-ce qui l’a amené à plonger sa tête sous le papier peint ou à préparer son envol perché sur un piédestal de fortune ? Évidemment, il n’y a pas de réponses à ces interrogations qui surviennent naturellement. Toutefois, ce va-et-vient que fait l’esprit s’avère contenir tout l’intérêt de ces photographies : chercher des causes, des précisions à ces situations absurdes engendre tout un univers autour de l’image, qui est dès lors un point de départ et non une fin. Libre à nous d’y voir une folie passagère, une référence savante, ou un jeu d’enfant.
————————————————————————————————————————————————————————————
Slap-Stick [Eng]
—
François Cheval, exhibition curator and co-director of the Lianzhou Photo museum
Guillaume Martial’s photography apparently begins and ends under the inflexible influence of geometry; vertical, horizontal and oblique lines tangle and transform in a joyful and carefree allegory of resistance. His photographic series assert an extreme precision. The meticulously elaborated image is the mark of a watchmaker who would have interlocked his blueprints like pinions and wheels, barrels and pendulums. Vigilant, the photographer is concerned with the details and their assembling. Because if one is to succed at representing the slapstick, which is the case here, this success relies entirely on each separate part, on all the little nothings. Perfectionist photography, bordering on obsessive mania, makes each component of the scene a decisive moment!
At the beginning, there is an action. Guillaume Martial’s body confronts architecture and the city. These are his playgrounds. The city is an enthralling reserve of unlimited experimentations. There, Guillaume Martial amuses himself with the rigid and taut structures of constructions. Under his multiple pointless and pathetic assaults, ash-grey concrete matter becomes a studio background, whose nature proves to be poetic and absurd. The sharpened body frees itself from it. The body is the weapon that best expresses the preposterous ideas suggested by architectural forms.
The wall section is the plane. The a priori minimal scenes emphasise the presence and the gestures of the photographer-model who, effectively, modifies the world order. The place and the structure of the monument are significant only because their uses have been circumvented. We’re made to believe that public space is like an horizon, always blocked. Therein lies the horror of urban determinism that would forever be impassable. Martial’s photographic stance optically and metaphorically puts into perspective a refutation. Here, each image asserts the extensive range of human possibilities, it refuses false impotence. The irony of the creative gesture replaces the logic of the engineer, the town and country planner and the bureaucrat…
What can we use to counterbalance the discipline of the line, mechanical logic and the functionalist project? Another utopia? This is hardly a favourabletime for emulators of Thomas More. Guillaume Martial contrasts totality thinking with an extravagant aesthetic, an ergonomics of his body as an experimental criticism of modernity. He could be this model, this highly awaited example of an extension of our creative capacities in an environment at last freed from rational usefulness.
The productivity and energy displayed in these playlets are powerful and pointless. This photography’s effectiveness does not lie in logical reason. It tests and takes risks. Hense, the importance of a practice that allows itself everything. By widening or shrinking the shots, these ‘martial’ fantaisies arrange themselves according to new norms that put the emphasis on the representation of chance. Through successive images and figures, the intention reconfigures the living and the monument, the ephemeral and the long term. These cubes, these right-angle parallelepipeds – Guillaume Martial doesn’t reject them. He appropriates them according to a coherent process of derationalisation of the city, now become matter that behaves unpredictably. In this sense, photography critical of contemporary town planning takes the form of a group of aberrant postures. Urban rigidity has found its antidote in the power of imagination and the body’s freedom, in determination, all qualities needed to see beyond the wallerected by the town planner and his friend the architect.
in the urban setting, the transition from the status of an alienated person, a man without bearings, to that of the individual integrated in the environment, presupposes a liberation. The struggle against these vertiginous walls, wich one must not be afraid to climb, is the sine qua non condition of emancipation. What is at play here is not a nostalgic return to an archaic state but the desire for an authentic life. The body, so often submissive, interior organ of the social order, fundamentally dependent on the power of the State, is paradoxically the tool of its own emancipation. Through his postures, Guillaume Martial offers a model of resistance that confronts and enters into dialogue with elements of a space to subjugate. He re-establishes the link between the project of a palpable upheaval of architecture and the end of urban reclusion, of anomie.
The postures are presented like a series of aphorisms or notations that shuffle, with an exquisite joy, one of the photographer’s favourite themes. Living is ultimately the affirmation of the self. This is not however an overexposure of the ego. On the contrary, his attitudes express the desire not to be recognised as the creator, because in many cases the photographer is unrecognisable. His perilous constructions are a necessity. A feeling of universality vibrates behind the apparent disorder stirring the photographer’s representations to life. Freedom, that which is proclaimed from the top of scaled monuments, can only be defended in the interstices, in its excavations, in short, in the gaps in the system.
Perhaps we are not all able to confront architectural culture in this way. But if we adopt this attitude, how can we not feel that it brings us closer to such a long-awaited place? The Dionysian power of these images.
————————————————————————————————————————————————————————————
Slap-Stick [Fr]
—
François Cheval, commissaire d’exposition et ex-conservateur en chef du musée Nicéphore Nièpce
La photographie de Guillaume Martial commence et finit, apparemment, sous le signe inflexible de la géométrie ; les verticales, les horizontales, les obliques s’enchevêtrent et se métamorphosent en une joyeuse et insouciante allégorie de la résistance. Les séries affirment une précision extrême. L’image minutieusement élaborée est la marque d’un horloger qui aurait imbriqué ses plans comme pignons et roues, barillets et axe de balancier. Vigilant, le photographe se soucie des détails et de leur assemblage. Car, parvenir à représenter le burlesque, c’est de cela dont il s’agit ici, repose tout entier sur chaque partie, sur de tous petits riens. La photographie perfectionniste, à la lisière de la manie obsessionnelle, fait de chaque composante de la scène un moment décisif !
Au début, il y a une action. Le corps de Guillaume Martial affronte l’architecture et la ville. Ce sont ses terrains de récréation. La ville est une réserve captivante d’expérimentations à volonté. Là, Guillaume Martial s’amuse avec les structures rigides et tendues des constructions. La matière cendrée du béton, sous ses multiples assauts vains et débiles, devient un fond de studio dont la nature s’avère poétique et absurde. Le corps acéré s’en détache. Il est l’arme qui exprime au mieux les idées saugrenues suggérées par la forme l’architecturale.
Le pan de mur est le plan. Les scènes, a priori minimales, soulignent la présence et les gestes du photographe-modèle qui, de fait, modifie l’ordre du monde. Le lieu et la structure du monument n’ont d’intérêt que dans leur pratique contournée. On nous fait croire que l’espace public est comme l’horizon, toujours bouché. Voilà bien l’horreur du déterminisme urbain qui serait à jamais indépassable. Le comportement photographique de Guillaume Martial met en perspective, optiquement et métaphoriquement, un démenti. Ici, chaque image affirme l’étendue des possibilités humaines, elle refuse les fausses impuissances. A la logique de l’ingénieur, de l’aménageur et du bureaucrate se substitue l’ironie du geste créateur…
Que peut-on opposer à la discipline du trait, à la logique mécanique, au projet fonctionnaliste ? Une autre utopie ? Les temps ne sont guère favorables aux émules de Thomas More. Guillaume Martial oppose à la pensée de la totalité une esthétique extravagante, une ergonomie de son corps comme critique expérimentale de la modernité. Il pourrait être ce modèle, cet exemple tant attendu d’une extension de nos capacités créatives dans un environnement enfin émancipé de l’utilité rationnelle.
La productivité et l’énergie déployées dans ces scénettes sont fortes et inutiles. L’efficacité de cette photographie ne relève pas de la raison logique. Elle teste et se risque. De là, l’intérêt d’une pratique qui s’autorise tout. En élargissant ou en rétrécissant les plans, les fantaisies « martiales » se disposent selon des normes nouvelles qui font la part belle à la représentation du hasard. Par images et figures successives, le propos reconfigure le vivant et le monument, l’éphémère et le long terme. Ces cubes, ces parallélépipèdes aux angles droits, Guillaume Martial ne les refuse pas. Il se les approprie selon un processus cohérent de dérationalisation de la ville devenue matière à comportements imprévisibles. En ce sens, la photographie critique de l’urbanisme contemporain prend la forme d’un ensemble de postures aberrantes. La rigidité urbaine a trouvé son antidote dans la puissance de l’imaginaire et la liberté du corps, dans le volontarisme, toutes qualités nécessaires pour voir au-delà du mur édifié par l’aménageur et son ami, l’architecte.
Dans le décor urbain, le passage du statut d’aliéné, un homme sans repères, à celui d’intégré à l’environnement suppose une libération. La lutte contre ces murs vertigineux, qu’il ne faut pas craindre de gravir, est la condition sine qua non de l’affranchissement. Ce qui se joue-là n’est pas un retour nostalgique vers un état archaïque mais le souhait d’une vie authentique. Le corps, si souvent soumis, organe intérieur de l’ordre social, foncièrement tributaire de la puissance de l’Etat, est paradoxalement l’outil de sa propre émancipation. À travers ses postures, Guillaume Martial pose un modèle de résistance qui s’affronte et dialogue avec les éléments d’un espace à soumettre. Il rétablit le lien entre le projet d’un chambardement sensible de l’architecture et la fin de la réclusion urbaine, l’anomie.
Les postures se présentent comme une suite d’aphorismes ou de notations qui brassent avec un bonheur exquis un thème cher à l’auteur. Vivre est finalement l’affirmation de soi. Ce qui n’est pas par ailleurs une surexposition de l’ego. Au contraire, les attitudes manifestent le désir de ne pas être reconnu comme auteur, car très souvent on ne le reconnaît pas. Ses constructions périlleuses sont une nécessité. Derrière l’apparent désordre qui anime les représentations du photographe vibre un sentiment d’universalité. La liberté, celle qui se proclame en haut des monuments escaladés, ne peut se défendre que dans les interstices, dans ses excavations, bref dans les lacunes du système.
Il n’est peut-être pas donné à tous de se confronter ainsi à la culture architecturale. Mais si on adopte cette attitude, comment ne pas sentir qu’elle nous rapproche du lieu tant attendu… La puissance dionysiaque de ces images.
————————————————————————————————————————————————————————————
PARADE [Eng]
—
Paul Wombell, curator and art director of France(s) Territoire Liquide, director of the Photographers’ Gallery in London (1994-2005) and curator in several international photo festivals
Working in the similar manner has a 19th century photographer on an archaeological expedition to photograph the ruins of ancient civilizations, Guillaume Martial has found strange architectural objects, wich suggest that they might have been built to honour a deity. He uses the pictorial convention of placing figures in the photographs to measure the size of the objects and test how they might have been used in the past. The photographs suggest that the objects might have been sites for human sacrifice to appease favour with a divine agency. If this is the case they might have been built to worship the deity known as Jacques Tati.
————————————————————————————————————————————————————————————
IMAGE Magazine [Fr]
—
Christian Caujolle, fondateur de l’agence VU’, écrivain et commissaire d’exposition
[…] Guillaume Martial développe un travail sur l’espace. Ce qui nous renvoie à la question du documentaire, c’est le fait qu’il mesure et invente l’espace avec son corps et avec la photographie. Il a énormément d’humour. C’est une photographie désinhibée et qui ne se regarde pas le nombril, consciente de sa pertinence et de sa force graphique et plastique.
————————————————————————————————————————————————————————————
Guillaume Martial , Corps, décors, (r)accords [Fr]
—
Anne Dumonteil, exposition The Player galerie Annie Gabrielli, octobre 2014
Ce qui saute aux yeux dans les séries photographiques de Guillaume Martial, c’est la présence récurrente de l’architecture qui est représentée, dans la plupart des images, de manière tronquée, fragmentée ou fragmentaire. Ainsi, dans la série Modulor, le cadre de l’appareil photographique ne retient qu’une partie d’un gymnase alors que l’ensemble Parade présente des vues d’espaces urbains, souvent périphériques, habités, tour à tour, par un réservoir, une façade esseulée, un portail ouvrant sur un mur, une rampe de skateboard, une potence ou encore une cage de football.
Soudain isolés, ces éléments d’architecture apparaissent comme des traces, des vestiges d’une activité révolue ou d’une civilisation passée. Le choix du noir et blanc et la lumière entre chien et loup des prises de vue contribuent certainement à l’étrangeté, voire à la désolation, de ces lieux.
Et puis, il y a le corps qui vient s’inscrire dans ces espaces. Ce corps, c’est celui de Guillaume Martial qui, après avoir été arpenteur de la ville, se fait acteur des lieux qu’il a sélectionnés.
Dans la série Parade, le corps s’affirme et s’affiche pour habiter les espaces et les incarner, autant qu’il en révèle et en souligne les formes et les contours. Faisant le choix de mises en scène de lui-même, précaires et dérisoires, le photographe s’approprie les constructions quotidiennes par les usages nouveaux qu’il en fait : supports du corps, chambre noire ou plongeoir improvisé. C’est par l’action et le geste que sont rendus visibles ces pans de réel, y compris les plus insignifiants.
Dans ces conjonctions du corps et du décor, les lieux deviennent le théâtre de saynètes dans lesquelles, à la gravité d’un monde déshumanisé, répond une implication corporelle aux accents burlesques et résolument vivante. En effet, par ses postures et son air impassible, Guillaume Martial réenchante le monde en lui insufflant une dose d’absurde et d’irrationnel.
Ceci est particulièrement vrai dans la série Modulor. Dans ces fables visuelles, le corps de l’artiste, masqué, transformé ou diminué dans ses capacités par des modules de couleur, est paradoxalement plus présent que jamais. Tel un acteur du muet, reconnaissable avec sa moustache et sa tenue de sport, le photographe devient un véritable personnage qui arrive, par le jeu avec lui-même, à faire triompher le corps avec humour.
Au travers des œuvres présentées dans l’exposition, Guillaume Martial fait la démonstration qu’il est possible de parler du monde et de la condition humaine au moyen de choses simples. Reste à savoir déceler dans la réalité les petits riens susceptibles de produire de grands enchantements…
————————————————————————————————————————————————————————————
PARADE [Fr]
—
Christian Rolot, professeur à l’université Montpellier III, spécialiste de l’histoire du cinéma comique
Les photographies de Guillaume Martial savent mieux qu’aucune autre redonner de la vie à ce qu’on croyait mort. Elles font redécouvrir les paysages, les espaces familiers, ceux que l’on ne voyait plus à force d’habitude, ou qu’on n’avait jamais vraiment regardés, les jugeant trop ordinaires.
Quel est donc le secret de cette résurrection ? Sans doute, sur les conseils de Flaubert, l’auteur observe-t-il les choses longtemps, mais également –et peut-être surtout– les regarde-t-il autrement, opérant ce léger décalage du point de vue qui stimule et rajeunit le regard.
Le photographe eut tout d’abord l’idée d’introduire, dans ses premiers clichés, l’observateur au sein même du motif observé : la découverte du monde qui nous entoure est un acte important, qu’il convient de ne pas accomplir distraitement. Aussi, la présence de ce témoin attentif affirmait-elle un principe éthique en même temps qu’un modèle de conduite. Mais cette présence, qui donnait au motif photographié le statut de chose vue, lui ôtait du même coup une part de sa réalité objective. Outre cela, il apparut rapidement que cette présence avait une autre conséquence : le personnage, conçu dans un premier temps comme l’outil d’une mise en éveil, tendait à prendre de l’importance jusqu’à devenir le sujet même de l’image, reléguant progressivement le paysage au rang de décor d’arrière-plan, de simple toile de fond.
Pour y remédier, la solution choisie semble, il faut bien le dire, assez paradoxale. Elle sera, contre toute attente, d’oser accorder davantage d’autonomie au personnage, faisant de lui, non plus un simple spectateur, mais l’explorateur actif de son propre espace. C’est par lui, en effet, par son action, ses attitudes, ses postures, que les paysages apparaissent sous un jour nouveau et qu’on en découvre les failles. Ainsi, l’incongruité de certains édicules étranges, pas forcément perçue lors d’un premier regard, saute-t-elle brusquement aux yeux jusqu’à en devenir comique. C’est par exemple ce portail n’ouvrant sur rien, cette façade de maison sans la maison, ou encore ce clocheton contrefait dressé vers le ciel comme une énigme. La lecture réorientée que nous en propose l’auteur, éclairante sans aucune pédanterie et toujours finement spirituelle, retend la peau de ces paysages urbains dénaturés, et crée la surprise. L’humour de Guillaume Martial entre évidemment pour beaucoup dans le plaisir que l’on prend à ces redécouvertes.
Or, le comique est comme la photographie : il a besoin d’un révélateur pour apparaître. Ici, le révélateur est le photographe lui-même, présent à la fois derrière et devant l’appareil. Car le personnage, c’est lui. Chaque fois, son corps révèle l’effet, aide au déchiffrement de l’image. Mais il reste stylisé, silhouetté ; il s’agit non d’un homme mais d’une idée d’homme, replaçant simplement, délicatement au sein des paysages photographiés un concept d’humanité. En contemplant ce long corps mince et l’éloquente pureté de ses gestes de mime, c’est presque Monsieur Hulot que, par instants, on croit apercevoir. Pas étonnant, dès lors, que Parade donne à réfléchir : ses quinze clichés nous racontent en tout petit l’aventure de l’Homme tentant de s’approprier un environnement qui lui échappe, d’un homme qui cherche en vain sa place dans un monde toujours plus complexe jusqu’à en devenir absurde.
L’existence de ce petit personnage, que l’on n’aperçoit jamais que de loin, donne en même temps beaucoup d’unité et de charme à cette Parade photographique. Dans chaque lieu visité, son intrusion, loin de faire diversion, nous recentre sur l’essentiel. Et si cette intrusion paraît dans un premier temps fausser le décor par quelque acrobatie architecte, ce n’est que pour le rendre plus vrai, de cette vérité jusqu’ici invisible que la perspicacité de l’artiste met soudain en lumière.
Les belles photographies de Guillaume Martial sonnent peut-être comme de petits mensonges lors des premiers instants, mais ce sont des mensonges qui, à l’instar de ceux de Jean Cocteau, finissent toujours par dire la vérité.
Encore un mot, juste pour souligner combien il est remarquable que ce jeune photographe, vu la nature de son sujet, ne soit jamais tombé dans les pièges de l’anecdote et du comique facile qui lui tendaient pourtant les bras. Parade est au contraire d’une belle rigueur intellectuelle, et sa délicatesse de touche, son élégance maîtrisée, le résultat d’un dosage indéchiffrable dont seuls, peut-être, les vrais poètes ont le secret.
————————————————————————————————————————————————————————————
Hôpital Circus ou Gymnastiques burlesques [Fr]
—
Jean-Michel Hellio, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, Ciné-Cinéma Périgueux
Guillaume Martial s’apparente à un éternel rêveur éveillé installé à la verticalité du monde, une silhouette « prototype », effilée, où le trait domine, qui scrute l’horizon telle une vigie portant moustache, mais également une allure éolienne qui n’est pas sans rappeler celle de Monsieur Hulot, une filiation étroite et sincère mais tout en retenue. Trois points de suspension à lui tout seul, dont le geste ultime consisterait à les assembler pour n’en faire plus qu’un assorti d’une barre verticale. Faire raccord, passer ainsi en un temps record de l’apesanteur à l’exclamation. Plus qu’une ponctuation, la revendication d’une parentèle libérée de ses parenthèses. Á l’égal d’un Harry Langdon, cousin d’équilibre par alliance, l’artiste est bien un apologiste de l’intervention à déclenchement différé, un virtuose du geste arrêté, quand il ne s’agit pas de son propre corps présenté en suspension le temps d’une épreuve photographique intitulée sobrement Lévitation.
Le quotidien de Guillaume Martial se nourrit certes d’expressivité physique et de jeu corporel, mais tout autant d’apesanteur comique reconstituée à partir des prélèvements du réel puis recrée dans le prisme d’une poésie burlesque associée à l’univers du cirque d’antan, plus particulièrement, celui de la troupe Ullman, compagnon de voyage inattendu de sa résidence montponnaise au centre hospitalier Vauclaire. Alchimiste de la piste et de ses alcôves, l’artiste se plaît ainsi à réinjecter dans son dispositif scénographique l’empreinte du spectacle circassien dans sa facture la plus noble, délestée de son versant spectaculaire, confrontant cette dernière aux ressorts du cinéma de la préhistoire et des boîtes à malice que sont la Camera Obscura et le Praxinoscope.
Un panneau « Entrée des artistes » en lettres d’or sur fond bleu invite le public à franchir le seuil matérialisé par le velours d’un rideau de scène ; à l’intérieur du Grand Cloître, la théâtralité s’affiche et infuse discrètement : deux guirlandes d’ampoules – vestiges d’un petit bal perdu – éclairent autant qu’elles décorent les lieux, deux étoiles rouge pompier se dessinent sur un sol balayé par une fumée qui met en scène l’artificialité revendiquée des univers convoqués, enfin, sur les murs l’alternance chromatique du rouge et du blanc séduit la pupille et conduit le regard vers une série d’impressions pigmentaires sobrement titrée Chapiteau. L’ensemble donne à voir le bâtiment conventuel et le restaurant du personnel couronnés pour ne pas dire chapeautés d’une impressionnante toile bicolore les transformant en chapiteaux de voyage immobile. Pour accompagner la déambulation, l’artiste a élaboré une bande sonore à multiples épaisseurs ou s’additionnent les voix, les timbres, les cris des résidents, où s’enchevêtrent les bruits atmosphériques mais aussi celui plus caractéristique d’une toupie de poche appartenant à un patient, sans oublier la musique tonique et enfantine du cirque Ullman, objet ludique et sentimental qui parle au cœur.
De ses années d’apprentissage, Guillaume Martial garde le souvenir de son expérience de patineur, corps encore adolescent, mais déjà lancé à la conquête de l’équilibre et, a fortiori, de l’expérimentation physique et sensorielle d’un espace. Á l’image des figures totémiques qui peuplent son panthéon cinématographique (de Buster Keaton à Pierre Étaix sans exclure les Marx Brothers et Peter Sellers), c’est bien d’un défi lancé à l’horizontalité du monde et de son point de fuite cartésien dont il sera question désormais. Non pas une perspective centrale perçue comme l’unique accès à l’œuvre, mais bien une multitude de foyers obliques qui balayent l’espace et facilitent l’irruption de l’inattendu à l’image de la composition Salle des fêtes.
On y observe au repos un personnage solitaire assis en retrait du monde et du juste milieu symbolisé par les portes battantes, une figure en méditation, géométriquement excentrée à l’arrière-plan, exilée sur la gauche du cadre. Et que les premiers assauts du gag en gestation rendront bientôt à sa bipédie burlesque. L’artiste affiche de toute évidence une précision d’horloger dans la préparation de ses tours de passe passe et leur exécution parfois capitale comme nous le restitue le parcours de sa propre tête tranchée dans Gravitation, réalisation qui n’est pas sans évoquer l’illusionnisme poétique et facétieux de Georges Méliès et de son célèbre métrage : L’Homme à la tête de caoutchouc. « Le burlesque est l’expression dramatique du terrorisme des choses » nous explique Michel Arnaud, nul doute que pour Guillaume Martial c’est bel et bien la mécanique des objets, la boucle, obsédante, la répétition incessante et paranoïaque de la rotation qui fonde son écriture et contribue à structurer sa grammaire visuelle.
Le comique de Guillaume Martial est discret et allusif, relâché et discontinu. La palette est vaste, l’écriture poétique, toujours à fleur de sujet, la sève comique délicatement filtrée au moyen de petites saynètes, sorte de petits jets à trucs et d’astuces à tiroirs-secrets : la course-poursuite (La Boucle), le personnage récurrent du scientifique-photographe ou de l’artiste de cirque sorte d’acrobate au corps malléable. Son burlesque est donc celui des origines, primitif et naïf, instantané et primesautier, mais rattrapé par la frénésie des attitudes corporelles confrontées à un chapelet de contraintes : contorsions et distorsions, emboîtements et escamotages, imbrications et hybridations, etc. Un monde extravagant aux accents baroques, tutoyant le fantastique, qui aurait mis en fuite son propre centre de gravité pour lui préférer une impulsion supplémentaire, une accentuation hyperbolique du sentiment dramatique de la vie, l’artiste puisant son inspiration non plus dans la mesure et l’ordre mais bien davantage dans la libération et la transgression. La phantasia plutôt que la mimesis. C’est dans cette perspective que l’artiste s’approprie le rituel du soin et de l’examen médical afin de nous les restituer sous la forme d’un bestiaire radiologique pittoresque composé de sept créatures naïvement futuristes dans Locomotion Animale, expérience fantasque qui confronte la technique chronophotographique d’Étienne-Jules Marey avec celle du négatoscope des salles de labo.
L’expression artistique de Guillaume Martial se situe à l’extrême pointe du burlesque, tiraillée entre un héritage classique fait d’union et de synthèse et une sensibilité aigüe pour la juxtaposition qui le rapproche de l’avant-garde artistique, à distance égale entre l’image fixe et l’image cinétique, entre la tradition poétique du gag construit à retardement et son efficacité narrative vécue à temps plein. Sonder les formes pleines du burlesque, les évider, refuser la surenchère qui conduit au débordement, à l’image des scénographies silencieuses du couple Abel et Gordon, tel est le projet de l’artiste.
Hôpital Circus ou l’intuition du métamorphisme de la vie, constant mouvement pendulaire entre le profane et le sacré, le banal et l’insolite, le visible et le masqué, le réel et le vrai. Car il s’agit pour l’artiste de rendre compte de l’angoisse latente de l’homme, individuelle ou collective, de transcender le monde naturel à l’aide de moyens artistiques spécifiques, d’une part, ceux du dramatique et de l’illusionnisme ; d’autre part, ceux de la distanciation et de la perte du réel comme en témoigne son Lancer de chaise antidaté vers 1875.
Contre le non-sens, l’infantilisation et l’hystérisation galopante de notre temps, les créations de Guillaume Martial issues d’un autre temps, nous redonnent confiance dans la vérité de l’instant et la magie de la vie.
————————————————————————————————————————————————————————————
Hôpital Circus [Fr]
—
Camille de Singly, professeur d’histoire de l’art à l’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux et présidente de Réseau Documents d’Artistes Aquitaine
Exposition de Guillaume Martial au CHS Vauclaire de Montpon-Ménestérol, Avril 2015, Montpon-Ménestérol (Dordogne). La salle capitulaire de l’ancienne chartreuse de Vauclaire reconvertie en hôpital psychiatrique accueille pour quelques semaines un drôle de cirque, l’Hôpital Circus. Dans cet étrange espace ayant conservé des éléments de ses affectations antérieures (les réunions du chapitre, le secrétariat d’un cabinet médical, un même un tournage de film…), Guillaume Martial, artiste et hôte, opère un tour burlesque et décalé, en fine intelligence avec les esprits des lieux et de ses occupants. S’y greffe aussi un peu du cirque Ullman voisin, que l’artiste a fréquenté pendant sa résidence de création.
Notre conditionnement (ou déconditionnement) commence dès la réception du carton d’invitation : le Cheval incarné par Guillaume Martial, animal à sept pattes humaines, est tout autant une chimère moderne qu’une apparition théâtralisée. Il a la légèreté blanche et éthérée des chronophotographies de Marey, et le ridicule émouvant des chevaux de cirque de Fred ou du malhabile Monsieur Racine de Tomi Ungerer. Jeu d’enfant ou jeu d’adulte, fiction éphémère ou croyance éternelle, il renvoie aussi à la fragile limite entre réel et irréel, normal et anormalité. L’histoire de Saul-Paul, tombé de cheval lors de sa conversion au christianisme sur la route de Damas, nous rappelle combien le basculement peut advenir à tout moment.
Au centre hospitalier, l’accès au lieu d’exposition est fléché, et les derniers éléments de signalétique absorbent le graphisme des panneaux de l’hôpital, écriture jaune sur fond bleu électrique, pour mieux brouiller les frontières entre ce nouveau monde et l’ancien. L’entrée de l’exposition, rebaptisée par Guillaume Martial « Entrée des artistes », annonce un discret « Sacrétaret ! » ; tout un prog(ana)gramme, terminé par l’ultime pirouette du « i » en « ! », l’exclamation et la tête en bas. On ne sait plus très bien, d’ailleurs, dans quel espace on pénètre, passés la porte et son drapé de velours noir. La partie haute des murs est celle d’une salle capitulaire naguère belle, aujourd’hui décrépite ; l’exposition occupe la moitié inférieure, enchâssée dans le caisson très propre et très artificiel d’un récent décor de film. La cimaise basse vermeil et deux étoiles asymétriques rouge feu dessinent une improbable piste de cirque, complétées par deux guirlandes d’ampoules cardinales. A intervalle régulier, la salle est partiellement plongée dans une fumée artificielle, au son de fragments enregistrés du cirque Ullman. D’autres sons sont plus difficiles à identifier, tel celui d’une toupie manipulée par l’un des patients, ou des cris.
Des tours créés par Guillaume Martial pendant sa résidence artistique ne nous sont présentées que leurs traces, photographies, radiographies, vidéo, comme les récits ou mises en image de miracles religieux. Leur fixité et une certaine raideur dans l’accrochage détonnent avec l’appel de la piste ; le cirque s’est aligné, pour le respect de la mémoire des lieux, ou la canalisation de ses dérangements. L’image assure aussi une perfection des tours, rien ne dépasse, les symétries sont parfaites. Dans Gravitation, impression pigmentaire de format carré, l’artiste a perdu la tête, tranchée nette par le cadre d’une image dans l’image, celle de la scène de la salle des fêtes du centre hospitalier. Multipliée et basculée, la capitula est devenue boule à jongler. L’artiste y est inexpressif, à l’instar de ces saints décapités : la croyance vainc tout. Le décalage est extrême entre le sérieux de l’artiste, la minutie de sa reconstitution miraculeuse, et cette absurde partie de boules de tête. Dans l’œuvre qui lui fait face, l’artiste lévite, avec son perizonium blanc ; il sort de la scène coupée, devenue tombeau. De l’homme au saint et au christ, du jongleur à l’artiste, de la normalité à la folie, il n’y a parfois qu’un pas de côté.
Un troisième tour voit l’artiste lancer des chaises en un beau demi-cercle ; les fils sont tout aussi invisibles, et rappellent les savantes constitutions d’images de Jeff Wall, ou même les premiers collages de l’histoire de la photographie (Oscar Gustav Rejlander, par exemple), créant illusion – l’œuvre est d’ailleurs antidatée à 1882. Pour ses tours de l’Hôpital Circus, Guillaume Martial ne tolère aucune imperfection ; il est maître d’un monde. Il a aussi transformé deux bâtiments de l’hôpital, celle, ancienne, de la Chartreuse et une autre plus contemporaine du restaurant en architectures circassiennes. Le basculement est cette fois purement virtuel, puisque ces œuvres n’ont jamais été pensées comme les photomontages d’une construction à venir, mais comme les outils d’une projection immédiate dans l’ailleurs de l’Hôpital Circus. « Le cirque arrive comme ça », dit l’artiste. On pense à la Genèse, mais aussi à la bande dessinée, qui campe ses décors d’un coup de crayon.
Trois objets complètent cet accrochage de photographies, interrogeant la saisie et l’enregistrement du visible / de l’invisible. Une camera obscura contemporaine ramène de la profondeur du temps le premier dispositif de capture du réel sur une surface en deux dimensions, ancêtre de l’appareil photographie ; dans l’exposition, elle permet de voir dans le « bon » sens une vidéo projetée sur le mur la tête en bas. L’artiste, passe-muraille en blouse blanche, y franchit un des murs du centre hospitalier cinq fois de suite avant de se heurter à la matérialité redevenue réelle du béton. L’image est accélérée, transformant la locomotion de l’artiste en course oscillante du premier cinéma burlesque. Plus loin, on peut activer un praxinoscope et découvrir l’artiste avancer à quatre pattes, en blouse blanche. Enfin, deux négatoscopes affichent les radiographies des sept animaux des locomotions animales. Aux côtés du cheval précédemment cité, un éléphant, une girafe, un serpent, et d’autres animaux improbables, tous constitués du corps de l’artiste multiplié, étiré, basculé.
Il n’y a pas de douleur dans les exercices impossibles et impassibles de Guillaume Martial, ancien sportif rompu à toutes formes de figures et de contraintes. On ne voit que le résultat ; disparaît la mécanique de fabrication, du geste ou de l’image, que l’artiste occulte volontairement. En cachant le faire, Guillaume Martial condense le temps et entretient l’illusion. Les trucs, les astuces, comme dans la magie ou le religieux ; le travail préparatoire et répétitif des sportifs et circassiens, nécessaire du perfectionnement ; tous sont rendus invisibles. On n’oublie pas cependant ce négatif, long, d’une prouesse éphémère, partie immergée de l’iceberg de l’histoire racontée. Car c’est aussi cette même répétition de gestes qui marque l’univers de nombre de patients de Vauclaire. Derrière la réitération de certains gestes, au quotidien, et au-delà de l’impression première d’enfermement, de sécurisation, il y a cette création d’un autre monde, qui nous échappe et dont nous ne percevons, finalement, que la trace extérieure. Dans Hôpital Circus, seule la fiction demeure.